Je vous avais déjà rapidement parlé de Law and order l’an passé : j’évoquais le délice d’une série terriblement sobre, anti-feuilletonesque, aux personnages débarrassés d’arcs scénaristiques lourdauds. J’ai depuis hésité à y consacrer un article : déjà parce qu’un problème technique m’en a longtemps suspendu la vision (les deux premières saisons sont de fait un peu floues dans mon souvenir), et surtout parce que Chow a déjà consacré un excellent papier à ces trois premières saisons (les replaçant, notamment, dans le contexte de la production télévisuelle de leur époque). Prenons tout de même le temps de nous y repencher : à l’heure des séries aux grands pitchs et aux narrations dopées, il est utile de chercher ce qui peut faire la qualité d’un programme si humble, si anodin d’aspect, qui se résume aujourd’hui au papier peint maussade des rediffusions TF1.
Law and order, série débutée en 1990, est en effet toujours en cours de diffusion, par l’intermédiaire des multiples spin-offs qu’elle a engendrés, et qui lui ont survécu, avec plus ou moins de fidélité à l’esprit de l’original. La série souche (celle dont je vous parle ici) a à elle seule duré vingt ans.
Le principe en est simple : chaque épisode se concentre sur une affaire criminelle, en se scindant en deux parties. La première suit le travail de la police de Manhattan, aux côtés d’un binôme d’enquêteurs ; puis l’affaire est transférée au parquet, où la série nous confie aux deux substituts du procureur. Du crime à la sentence, chaque affaire traverse donc toutes les étapes du système judiciaire américain, qui restera le premier centre d’attention : la vie privée des personnages, en dehors de leurs heures de travail, nous est totalement inconnue. Que l’on parvienne malgré tout à s’attacher à eux, comme on apprivoiserait ses collègues, n’est pas la moindre étrangeté de ce programme…
Aux portes de Babel
La série a vu le jour au plus haut de l’histoire criminelle de New York, dont les chiffres avaient bondi en flèche au cours des années 70, pour atteindre 1500 à 2000 meurtres annuels dans les années 80 (l’ironie veut que le pic criminel de la ville, avec 2245 meurtre, fut l’année 1990, soit celle de la création de la série). Law and order est donc l’enfant de cette métropole pré-Giuliani (dont la célèbre politique incarcératoire, dite de « tolérance zéro », ne débutera qu’en 1994), et en garde les marques. Mais pas forcément de la manière dont on l’attendrait…

Le labyrinthe infini de Manhattan (épisode 2-18)
En effet, avant d’être criminel, le New York que peint Law and order est surtout un cloaque. Je repense aux paroles d’un cinéphile tchèque, qui me parlait de la libération qu’avait constitué, sur les écrans de sa jeunesse, le cinéma pourtant rieur de Věra Chytilova (et notamment son court-métrage Un sac de puces) : il y avait soudain, me disait-il, un film qui nous montrait à l’écran que ce pays était sale, qu’il sentait mauvais – une libération. De même, ce New York au sortir des années Reaganiennes semble soudain se déshabiller et exposer ses croutes, ou du moins s’observer sans le filtre du glamour, d’une façon presque documentaire (une approche qui commencera à disparaître dès la saison 3, déjà plus lisse).
Ce serait faire fausse route de voir dans cette forme un réquisitoire, une charge anticapitaliste par exemple (difficile, en fait, devant la série, de deviner la couleur politique de Dick Wolf). Law and order confronte certes constamment ses inspecteurs à l’actualité de sujets de société brûlants (racisme, drogue, incapacité des services sociaux…), de manière d’ailleurs souvent didactique. Mais l’ambition de la série, sur le plan sociologique, tient plutôt de la fresque, de la grande mosaïque aux proportions bibliques : ce que Wolf tente d’établir, épisode par épisode, c’est un état des lieux de New York.
les milles et un visages de l’Amérique (épisode 1-09)
Défilé d’endroits, de visages, de communautés, de portes d’immeubles abandonnés déboulant sur d’autres arrière-cours, de périphéries de ports, de ruelles, de boîtes douteuses ou de commerces brinquebalants : le cloaque est d’abord à labyrinthe, un labyrinthe sans fin1. Il va de pair avec ce monde américain de la débrouille ou du micro-entreprenariat, cocotte-minute d’anonymes où chacun descend, s’élève, au gré de ce qui semble être le bouillon d’une vaste réaction chimique. Ce n’est ainsi pas tant la pauvreté de New-York qui marque d’abord le spectateur, que son ébullition : chaque personnage croisé est totalement débordé, pris dans le flux de son travail, de ses magouilles, ou de sa propre survie (le tout premier épisode de la série débute ainsi dans un hôpital surchargé). Pour circuler dans ce chaos, la série se perd dans un océan de dossiers, d’archives, et de notes administratives, base de donnée protéiforme où chaque personnage interrogé farfouille (la série documentant, par là-même, un autre fait sociologique de son temps : la compliquée transition administrative de l’Amérique des années 90 vers l’informatique). De l’ordinateur d’hôpital au placard à archives du petit entrepreneur, c’est toute l’Amérique qui semble répertoriée, comme sur un gigantesque disque dur d’écrans et de papiers.
Le labyrinthe tient aussi au défilé de têtes et de figurants. Au cours de l’enquête, nombreux sont les personnages qui ne passeront que quelques secondes à l’image, sans forcément intégrer le récit : telle voisine vieille et aigrie, qui referme la porte ; telle gardienne de crèche, qui n’aura le temps que pour trois mots aux inspecteurs, en essayant de faire rentrer les enfants dans le bâtiment, et qui doit déjà retourner à son burn-out ; ou telle infirmière qui a pris le contrôle d’un hôpital en chaos, manageant les internes avec une souveraine assurance2… Le casting, remarquable, ne cherche pas tant dans ces visages des échantillons représentatifs, qu’à construire un mille-feuilles de fictions possibles : chacun de ces figurants, avec ses tics, ses manières propres, son métier, est d’abord un personnage potentiel, un petit monde à lui tout seul. Ainsi en est-il de ces duos de flics anonymes, qui découvrent un corps dans le prologue de bien des épisodes : binômes pareils à celui des inspecteurs stars de la série, qui semblent se connaître depuis toujours, avoir leurs propres habitudes et un passé bien à eux, et qu’on ne reverra plus jamais. Ils dessinent eux aussi, en creux, le portrait du géant réseau policier de la métropole, rempli de ces petits personnages inconnus abattant chacun leurs 20h par jour…
L’originalité politique de la série tient ainsi à son ambition de filmer l’Amérique comme ce grand melting-pot d’anonymes, tout en restant assez opaque sur la réussite d’un modèle si socialement et ethniquement fragmenté. Les tensions intra ou inter-communautaires restent le principal ressort dramatique des affaires criminelles, les fractures sociales semblent béantes, le rêve économique américain ressemble souvent à une farce. Seul l’appareil judiciaire qui leur fait face est idéalisé au-delà de toute mesure : approché comme une pure idée, jamais remis en doute, attestant de la grandeur du pays, et garant de son unité.

la confrontation avec les traders (épisode 2-22)
Cet idéal s’inscrit dans la structure même des épisodes. Le systématisme de la série (sa première partie policière, sa seconde partie judiciaire), en ce qu’il s’applique indifféremment, en toute neutralité et sans rien changer de ses manies, à n’importe quel visage lui passant dans les mains (blanc, noir, immigré, riche, pauvre…), participe à convoquer tous ces personnages à égalité, résumant par là-même l’idéal communautaire américain (peuple en mosaïque, mais tous égaux devant les institutions)3. La chose est particulièrement saisissante dans le final de la saison 2, qui pose le pied dans le milieu des traders, que la série filme de façon aussi documentaire (et avec aussi peu de glamour) que les bas-fonds de Manhattan : ce face à face avec la dernière classe sociale manquante au puzzle sociologique de la série (évoquant, en cela, quelque boss final de jeu vidéo4) dit cette obsession de faire un état des lieux complet et exhaustif de New York, avec la même attention dépassionnée pour tous ses habitants.
Les deux hémisphères
Ce fourmillement du tableau sociologique, avec sa part de documentaire et d’aléatoire, la série le transcende donc par un ferme parti-pris fictionnel : celui de scinder chaque épisode en deux. Car décider de suivre d’abord les policiers, puis ensuite les juristes, n’est pas qu’un moyen d’épouser la chronologie du système judiciaire américain : c’est aussi une manière, presque schizophrène, de faire cohabiter deux mondes que tout sépare au sein d’une même série.
Le monde des policiers, proche de ce qu’on attend habituellement d’un polar télévisé, nous est plus familier que l’autre : dans Law and order, si les juristes et leurs subtils entrechats législatifs évoquent la poésie, les enquêteurs sont indéniablement la partie en prose. Leur mode de fonctionnement est l’action, leurs dialogues sont blagueurs et décontractés, et étant loin d’être riches, ils ont un contact plus naturel avec les classes populaires. Ils ont des préjugés parfois plus ancrés, qu’ils acceptent sans mal de voir remis en question, mais rarement d’une façon qui les obligerait à aller s’interroger en profondeur – le monde des policiers reste celui de la surface, du quotidien sympathique et fatigué, et les tentatives d’une psychologue pour interroger les soubassements de ce train-train, dans le premier épisode de la saison 2 (on y revient plus loin), nous montrent que ce monde n’est absolument pas prêt pour ça. Bref, la police est la part ordinaire du système, en contact direct avec cette réalité du pays que la série investit, et leur commissariat (à commencer par leur chef épuisé) ressemble en tous points aux lieux décrépis, débordés et bordéliques, qu’ils visitent dans leurs enquêtes.
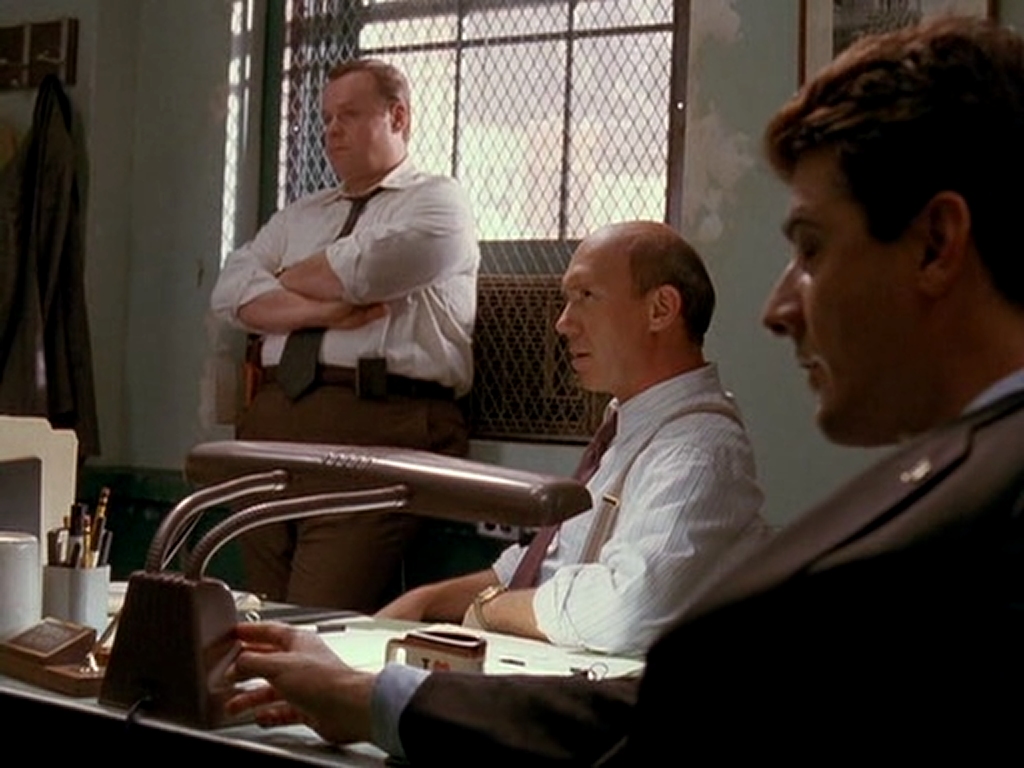
entouré de ses deux inspecteurs (George Dzundza et Chris Noth, épisode 1-11)
Le monde des juristes, lui, est celui des beaux bureaux – le tribunal, dont la coursive domine le hall en contrebas, est d’ailleurs le seul lieu que la série filme avec une certaine déférence. Ce surplomb se retrouve dans le rapport aux affaires : les policiers n’ont aucun mal à être sur le terrain de la morale, mais ils le sont d’une façon qui évoquerait la discussion de comptoir, l’indignation sanguine. À cette colère, les trois juristes opposent un fonctionnement plus froidement logique (c’est le motto de chaque épisode : « oui votre homme est un salaud, mais il faut négocier sa peine » ; « oui ce meurtre est sordide, mais on ne peut pas aller au procès avec si peu d’éléments »). Leur humanisme tient à un regard de haut : celui de la plaidoirie bien sûr (qui est un prêche), mais aussi celui de ces sentences finales qu’on lâche lors de dernières scènes nocturnes et fatiguées, dans le riche bureau du procureur (« Comment ces gens dorment la nuit ? », « Le monde est devenu fou… »), exactement comme on commenterait le monde du haut d’une baie vitrée. Cette singularité des juristes s’inscrit dans leurs relations-mêmes, marquées par une hiérarchie affirmée (quoique amicale) : quand le premier substitut envoie le second sur le terrain, c’est en lui ordonnant clairement quoi faire (alors que les deux policiers enquêteurs, quand bien même ils sont junior et senior detective, travaillent en équipe et en toute égalité).

et ses deux substituts (Michael Moriarty et Richard Brooks, épisode 3-18)
Le fossé entre ces deux mondes s’exprime aussi d’une manière plus secrète : par le jeu des acteurs, qui est le véritable miel de la série. Il est ici temps du parler du joyau brut de ces premières saisons de Law and order : Michael Moriarty (photo en tête d’article), qui interprète le premier substitut du procureur – acteur qu’on garde pourtant plutôt en mémoire pour avoir été alcoolique sur le plateau, instable en promo, et finalement remercié après quatre ans de service. Principale incarnation de la justice dans la série, il oppose aux accusés plus ou moins agités un jeu presque somnambule, visage doux et ouvert, phrasé fait de pauses et d’attente, regard pénétrant décryptant tranquillement son interlocuteur. Tout le jeu de Moriarty se construit autour de ce calme et de cette immobilité physique, qui font que ses paroles, toujours proférées sur le même ton égal et rêveur, semblent parfois sortir de lui inconsciemment, comme de la bouche de quelque pythie. Par là-même, son jeu cristallise à la perfection le côté à la fois profondément humaniste et glacialement logique de la loi, comme un intermédiaire humain entre la constitution, la législation, et ceux qui viennent s’y confronter.
D’une certaine manière, les deux autres juristes agissent comme des harmoniques, des déclinaisons du jeu si particulier de Moriarty. Richard Brooks (le second substitut), grands corps droit et visage opaque aux sentiments peu lisibles, s’immobilisera souvent dans les pièces où il vient parfaire l’enquête, comme pour radiographier les pièges que tend la situation autour de lui : sa position de jeune homme noir ayant réussi, dans un métier qui le confronte parfois à son milieu d’origine, en fait un personnage sur ses gardes, silencieux et méfiant. Steven Hill (qui joue le procureur) offre lui la présence tout aussi immobile d’un corps massif, humaniste et fatigué, vouté ou enfoncé dans ses fauteuils, mesurant et économisant les rares mots qu’il articule avec peine5.
La traditionnelle image du générique du début, qui montre flics et juristes marcher de concert, est donc un mensonge : Dick Wolf veut sans doute par elle signifier que l’ordre et la loi travaillent main dans la main – mais au fond tout est fait, à l’écran, pour séparer ces deux mondes.
À ce titre, le geste le plus étrange qu’opère la série est la transition, à chaque épisode, entre ces deux univers. Cela consiste toujours en un simple passage de relais, qui advient généralement lors d’une courte scène où le substitut du procureur rend visite aux policiers : la séquence et le personnage juriste arrivent toujours innocemment dans le récit, s’insérant l’air de rien dans la continuité, de manière anodine, comme de passage – et lorsque la scène finit, nous sommes surpris de voir que notre point de vue a été comme subtilisé, repartant de la scène avec un autre personnage, et un autre univers, que ceux avec lesquels on y était entrés… Chaque milieu d’épisode est ainsi comme un petit deuil. Bien sûr, cet effet de passe-passe admirable tient en partie du mirage, accentué qu’il est par l’exploitation vidéo : lors des diffusions TV, une coupure pub venait franchement souligner la césure. Mais il suffit de voir parfois l’épisode organiser un retour tardif des inspecteurs (le temps d’une scène où les juristes ont besoin de collecter de nouvelles preuves, par exemple), pour sentir combien on avait déjà oublié le point de vue des flics (ce point de vue pragmatique, débonnaire, terre-à-terre…), et comme on s’est déjà habitué à l’autre monde, et à ses usages (le monde doré des juristes, de la parole, de l’éthique). L’effet est toujours choquant, comme une fausse note amusée qui souligne les changements de notre identification.
Un élément viendra, de temps à autres, perturber ce système terriblement binaire : c’est la psy. Une anomalie – ne serait-ce que parce que dans les trois premières saisons, elle est l’unique femme que comptera la série. Son entrée en matière, en ouverture de la saison 2, la montre presque effrayée par ce milieu de fous qui s’ignorent, et qui n’ont aucune idée des soubassements régissant leurs certitudes : face à la fureur bêtasse du jeune policier en deuil, le jeu de Carolyn McCormick apparaît éminemment prudent, pesant chaque mot, comme si elle savait les répercussions du moindre terme sur un univers cumulant autant d’impensé.
Cette façon d’introduire le personnage dans la série est révélatrice. La façon dont la psy essaie, par petits pas, de ne serait-ce que suggérer un arrière-monde à cet univers policier (une attitude qui persistera dans ses premiers épisodes, où elle leur explique les choses patiemment, presque comme à des enfants), définit d’emblée son rôle, cette couleur étrange qu’elle appose au pragmatisme de la série. Qu’y a-t-il derrière les certitudes béates du système judiciaire américain ? Un premier tiroir à double-fond serait la sociologie : une injustice patente au sein de la cité, à laquelle la série s’attaque de front. Mais les réalités de l’inconscient que défriche la psy constituent un territoire moins explicite – et très vite, ses collègues lui accorderont une confiance absolue, comme s’ils se considéraient d’emblée hors-jeu pour comprendre le moteur profond de ces affaires auxquelles ils s’attaquent pourtant tous les jours.
Ce personnage de psy, s’il est bien sûr d’abord convoqué pour des raisons ludiques (psychologie du dimanche, jouer au profiler avant l’heure…), se présente aussi à nous comme la clé poétique de tout ce petit monde, dont elle est l’altérité totale. Comme un bug, un anti-venin que la redoutable machinerie se serait auto-injecté, et qui au milieu de la confiance aveugle en les vertus du système, suggère qu’il pourrait exister autre chose, pour régir ce monde, que la loi et l’ordre.
Notes
2 • Ces trois exemples viennent d’un seul épisode (le 2-18). Le premier personnage cité n’aura qu’une importance circonstancielle dans l’intrigue, les deux autres n’en auront aucune.
3 • La troisième saison, qui commence à s’ennuyer de ce système binaire, tend plus volontiers à mélanger la partie policière et judiciaire (les deux milieux se croisent et s’interrogent plus souvent, une faute de procédure des flics rend une preuve inutilisable au procès, etc.). Il est alors évident que la série cherche à renouveler sa formule, en inventant des cas particuliers mettant à mal ses propres habitudes. Mais il est curieux de voir combien la sociologie passe alors au second plan, au profit de cas policiers (tueur sadique, manipulation conjugale, casse-tête de juriste…) qui utilisent certes toujours les sujets sociaux (imports de produits frelatés, esclaves modernes…), mais à présent plutôt comme leur outil. Et ce qui a changé, précisément, c’est que la structure strictement bicéphale de la série, qui incarne très concrètement, très littéralement, l’idéal d’un système policier et judiciaire américain s’appliquant de la même façon à tous et à tout, n’est alors plus opérante.
4 • L’épisode en question discute un peu plus explicitement, à travers le personnage du syndicaliste, des injustices sociales dont la série nous a montré les effets. Et cette confrontation finale avec le milieu de la bourse peut ainsi se lire autrement : comme une lecture de la crise économique. La série n’a cessé de nous montrer un New-York de galère, pauvre, fracturé de toutes parts. Les requins que l’on découvre dans ce dernier épisode semblent alors être la genèse (le libéralisme fou des années 80) du chaos qu’on a sous les yeux depuis deux saisons.
5 • On notera que face à eux, les policiers opposent un jeu d’acteur radicalement inverse, c’est-à-dire quotidien et familier : jeu nerveux et dynamique du jeune premier (Chris North), et paternalisme bienveillant de ses brigadiers successifs (le débonnaire et "bon copain" George Dzundza, l’intelligent et malicieux Paul Sorvino, le plus cynique et ironique Jerry Orbach). Là encore, une figure de chef épuisé (excellent Dann Florek) vient parfaire le trio, mais son épuisement n’a rien à voir avec celui du sphinx-procureur : c’est une fatigue concrète, pragmatique, corps actif traînant les rides et l’usure de ses innombrables heures supplémentaires, et faisant régulièrement sentir à ses agents que sa patience s’effrite.


