Le hasard fait qu’au moment où l’on a appris la mort de Bertrand Tavernier, je venais tout juste de commencer à explorer son imposante filmographie. De Tavernier, je ne connaissais jusqu’alors que les textes (ces 50 ans de cinéma américain régulièrement parcourus à l’occasion de mes recherches), ainsi que ses interviews passionnées – je connaissais et respectais en lui le cinéphile et le passeur, plutôt que le cinéaste, dont j’avais une image molle et secondaire. Ce préjugé ne reposait en fait sur pas grand-chose d’autre que ma réticence générale envers le cinéma populaire français de cette époque, car de Tavernier je n’avais vu que La Fille de D’Artagnan (visionné enfant, en famille, aucun souvenir), et L.627 (vu adolescent, dont j’étais sorti diverti sans être plus enthousiasmé).
Durant ce premier semestre 2021, où il m’était difficile de lancer le moindre film, ces œuvres se sont distinguées par leur stupéfiante facilité de visionnage. L’efficacité et la fluidité narrative de ce cinéma, son pouvoir de conteur, n’est pourtant qu’une des pièces du puzzle Tavernier – ce cinéphile qui n’eut de cesse, comme on le lui reprochait, d’aplanir ou d’ignorer les lignes de séparation ancestrales de la cinéphilie nationale, et qui s’échinait en tant que cinéaste à construire des ponts, au sein de son œuvre-même, entre des choses jugées irréconciliables : perpétuant un cinéma de qualité française tout en le nourrissant des modèles (hollywoodiens, modernes, naturalistes…) qui lui ont été contraires ; et mariant une maestria narrative toute américaine à un ancrage profond dans le territoire et l’Histoire de France.
De cette filmographie à la fois populaire et érudite, et toujours soigneusement scénarisée, éclectique aussi du point de vue des genres (malgré une prédominance du film historique), la principale étrangeté reste encore le fossé entre ce chaos d’influences cinématographiques, et l’aisance apaisée de la forme qui en résulte, qui semble aller souverainement de soi, comme ignorant totalement qu’elle est l’enfant d’un champ de bataille.
Comme une certaine tendance…
« J’ai peint comme on m’avait appris. J’ai cru mes maîtres – le respect des traditions, les règles, peut-être même un peu trop. L’originalité, je la voyais, mais chez les autres. La grande exposition Cézanne en 96-97, c’était intéressant, mais je me disais “où est-ce que ça peut m’amener ?”. (…) Peut-être j’ai manqué de courage, j’aurais pu me décider il y a quelques années à changer de manière. J’y avais pensé sérieusement (…). En imitant l’originalité des autres – je veux dire ceux que je comprenais (…) – j’aurais été encore moins original, j’aurais perdu ma petite musique. Enfin, c’était la mienne. J’ai peint comme je le sentais, avec honnêteté. Et si je n’ai pas mieux réussi, du moins j’ai entrevu ce que j’aurais pu atteindre ».
Beaucoup ont été tentés, et moi le premier, de voir dans ce monologue mélancolique du vieux peintre académique d’Un dimanche à la campagne (1987) une sorte d’aveu, un autoportrait triste et lucide de Tavernier cinéaste, conscient de n’avoir été que le continuateur servile, et désuet, d’une certaine tendance du cinéma français d’après-guerre. Ses partisans s’en défendent : ce ne serait là qu’un autoportrait de Bost (c’est lui qui écrit le livre dont le film est adapté), ou encore un portrait de Tavernier père (qui était écrivain). Il reste que dans ce petit texte résident plusieurs vérités du cinéaste : celle d’avoir été, en effet, un continuateur (et plus encore : le seul continuateur) d’un cinéma méprisé par les réalisateurs modernes qui lui ont succédé ; et d’avoir aussi été, par son refus de suivre les modes, une petite musique singulière dans le cinéma français de la deuxième moitié du siècle. Comment faire son chemin à travers ce fatras ?
Reprenons du début. Pour écrire son premier long-métrage en 1974, Tavernier va chercher Aurenche et Bost1 : le premier écrira les scénarios de trois films majeurs de Tavernier, le second verra l’un de ses romans adaptés par le cinéaste. Les deux, enfin, seront les protagonistes de l’une des dernières grandes fictions de Tavernier, Laissez-passer (2002), chant d’amour pour le cinéma de qualité française tourné durant la guerre, et dont Aurenche est l’un des personnages principaux.
Ce topo explique à lui-seul en quoi, pour toute une frange de la critique (notamment pour la lignée issue des Cahiers du cinéma), la carrière de Tavernier fut une sorte d’affront. Et en lisant certains retours critiques du tourbillonnant Laissez-passer (2002), qui semblent n’y voir qu’une sorte de Faubourg 36 de luxe (plaisir brocanteur de la reconstitution du bon temps passé, accusation d’académisme), je ne peux m’empêcher, dubitatif, de penser que le problème principal de la réception du cinéma de Tavernier fut d’abord celui d’une grille de lecture crispée et préalable – d’une paire de lunettes déformantes et réticentes abordant ces films comme sur la défensive, y trouvant sans mal les objets de ses craintes, tout en restant aveugle à tout ce qui à l’écran pouvaient les reformuler, les transformer, les remettre en perspective. Encore aujourd’hui, les seuls films que les détracteurs de Tavernier acceptent sont ceux qui envoient assez de signes de flirt avec le cinéma moderne (La Passion Béatrice, La Guerre sans nom) pour montrer patte blanche… L’énigme de son cinéma ne s’en trouve pas plus résolue.
Cette réticence critique, cela dit, ne repose pas sur rien. Aurenche et Bost ne sont pas que des noms, et si leur style scénaristique n’eut pas toujours l’académisme qu’on prétend, ils amènent dans leurs valises un certain nombre de choses. À commencer par le plaisir du dialogue savant, l’art du bon mot populaire, au service duquel se met la caméra… C’est visible dès la première scène parlée du premier film de Tavernier, dans un échange de groupe (habitués au café se lançant des bons mots, le tout déjà mâtiné de politique) qui semble directement sortir de ce que les années 30 et 40 eurent de plus conventionnel. Cet héritage sera toujours là intact, 20 ans plus tard, à l’autre bout de la filmographie (et avec un autre scénariste), dans les réflexes très reconnaissables parcourant Capitaine Conan (échanges gouailleurs entre soldats par-ci, lyrisme au tragique factice d’un chant de femme par-là…).
Du cinéma populaire des années 30 et suivantes, on retrouve quelques autres signes. La complaisance d’une vision désenchantée du monde, parfois, ou son goût pour la médiocrité ordinaire, comme dans Coup de torchon (1981) qui électrise sa misanthropie par des éclairs de violence satisfaits (tirer sur les morts…), et qui étale un goût pénible pour la description des humiliations et de la laideur du monde (les toilettes et leur merde dans laquelle on patauge seront tout naturellement un décor du film). Comme à la grande époque du réalisme poétique, tout le monde est philosophe, le pilier de bar du coin balançant ses leçons de vie en deux mots bien sentis, si bien écrits, entre deux scènes au symbolisme maousse… Il n’est pas anodin non plus que, dans l’hommage au cinéma national que constitue Laissez-passer, les deux héros de Tavernier soient un scénariste et un assistant-réalisateur, dans un décentrement qui célèbre l’artisanat parallèle à la mise en scène. Tavernier circonscrit alors un âge d’or qui se définit autrement que par la qualité finale des films tournés, question relativement peu évoquée – le seul réalisateur mis en avant dans le film, Maurice Tourneur, est peint en dinosaure sage et fatigué, distant puis quelque peu dépassé (il finit par déléguer la réalisation) ; et le principal piment artistique de la période, à savoir Clouzot, restera strictement hors-champ.
Ce côté vieille France latent, traînant, se ressent enfin par une porosité involontaire des films à la pensée et à certains automatismes de leur temps, malgré le progressisme moral dont ils se revendiquent. Il est par exemple frappant de voir combien cette filmographie qui prend si souvent le parti des femmes, qui se conçoit même féministe en chantant leur martyre ou leur indépendance, va automatiquement déshabiller toutes ses jeunes premières (Marie Gillain, Julie Delpy, Christine Pascal…) sans que le désir soit toujours forcément l’enjeu de ces scènes ; elles seront souvent les compagnes multiples d’hommes ventripotents et plus vieux, seront toujours disponibles à leurs désirs2, épaule offerte à leurs soucis. On offre tranquillement une prostituée à un collègue dans L.627 ; le machisme ordinaire dans Capitaine Conan passe sous les radars d’une lutte des classes qui se rend aveugle à tout le reste… Et quand Julie Delpy avoue, dans un récent entretien, que le tournage de La Passion Béatrice a été cauchemardesque à cause de son partenaire masculin à l’écran, redoublant sur le tournage l’oppression que nous raconte le film, on se demande quoi penser de la caméra de Tavernier, qui semble plus occupée à idéaliser la beauté juvénile de l’actrice qu’à s’en faire le compagnon de lutte3.
Il n’y a dans tout cela rien de scandaleux (il n’est pas ici question de faire à Tavernier un procès en lèse-féminisme), mais simplement un exemple d’impensé de la forme, où cohabitent des revendications morales, des parti-pris auteurisants, et une perméabilité aux normes du cinéma populaire d’alors, dont on perdure mollement les valeurs et les automatismes. C’est là, il me semble, ce qui insupporte réellement les détracteurs du cinéma de Tavernier : ce soupçon d’un manque de précision et de fermeté, l’efficacité artisanale de films aux grandes prétentions politiques, mais qui seraient aveugles à ce qui court sous leurs plans (et ce quand bien même, formellement, ce cinéma ne paraît jamais vieilli : à bien y réfléchir, le seul film qui m’ait donné l’impression d’un classicisme désuet, et pas désagréablement d’ailleurs, est La Princesse de Montpensier).
Là est le premier conflit, mais aussi le premier aveuglement : pour toute une génération critique ayant grandi dans la religion du plan comme on coupe au scalpel, du cadre ou de la coupe comme prise de position (le très emblématique travelling de Kapo ne parle de rien d’autre), il y a une incompatibilité fondamentale avec le cinéma de Tavernier dont la caméra lyrique, tout en élans et envolées, semble chercher l’efficacité, plutôt que la justesse ou la précision. Or c’est mal regarder ces films, qui parlent à leur spectateur d’une toute autre façon. Quand Tavernier en interview discute de mise en scène, celle de L.627 par exemple, il est frappant de voir combien il ne parle jamais au détail (tel cadre, telle coupe, tel plan qu’il aurait défendu ou chéri), mais toujours en termes de parti-pris globaux, de tendances longues : par exemple, ce choix de toujours épouser le point de vue des policiers seuls (et jamais celui des malfrats, des passants, ou de l’institution) ; de toujours insérer des irruptions ou des interruptions dans le plan (ne jamais le laisser tranquille) ; de ne jamais faire de la scène suivante une situation qu’on pourrait déduire ou continuer de la précédente ; de mixer le son en mono quand on est dans les bureaux Algeco, pour rendre ceux-ci étouffants sur la longueur ; de cadrer le groupe entier quand ils parlent, plutôt que de découper leurs échanges…
Autant de choix de mise en scène qui se vérifient effectivement sur le film, mais dont les buts ne sont jamais dissociés d’une recherche de pure efficacité (suspecte, forcément suspecte…), et qui ne font par définition effet que sur la longueur (de par leur répétitivité, leur constance), déniant de fait tout pouvoir à la scène seule. Un ami peu friand de Tavernier, qui avait commencé La Princesse de Montpensier, me disait récemment comment il avait d’abord été ennuyé et atterré par le film (par sa mollesse, son jeu d’acteurs inégal), avant de se surprendre entraîné par la narration, toujours devant son téléviseur après deux heures passées. J’ai moi-même été surpris, en essayant de revoir une scène (celle du long parcours à bicyclette) qui dans Laissez-passer m’avait profondément ému, ne rien y trouver de particulier à y adorer, ou à y remarquer : elle ne déploie sa poésie et ne parle que dans la suite des péripéties excitées où elle s’insère (dissociation soudaine entre l’effort du personnage qui continue à vide et le relâchement épuisé du récit, émergence d’une absurdité aux accents tragiques, et ainsi de suite).
Cette recherche d’efficacité, qui est en fait plutôt un goût pour l’énergie, est aussi un moyen par lequel le cinéma de Tavernier s’est arraché au modèle de la qualité française : par la vitalité de sa narration en flux, par sa vitesse et son rythme effrénés. Dès l’ouverture de son deuxième film, Que la fête commence (1975), un vaste travelling sur un homme en course embrasse l’immensité d’une Bretagne qui soudain, instantanément, se fait ample territoire romanesque, sortant instantanément la France de son petit folklore. Le goût de Tavernier pour le cinéma américain n’est pas étranger à ce genre de parti-pris : ce dernier contamine sa filmographie de partout. Vues immenses en cinémascope des grand territoires vides du Nord, qu’un instituteur traverse seul en voiture tel un shérif (Ça commence aujourd’hui) ; désert de western sans foi ni loi, où la civilisation semble loin (Coup de torchon) ; chassés-croisés Altmaniens, et plaisir typiquement Hollywoodien à regarder les personnages travailler en équipe, collaboratifs, débordés, entre cernes et cafés (L.627, Ça commence aujourd’hui, Laissez-passer) ; ou encore cette façon de raconter, comme dans La Prisonnière du désert, la manière dont un pays doit sacrifier les hommes sauvages qui ont fait sa victoire, indésirables une fois la paix gagnée (Capitaine Conan).
Ce qui est curieux est que l’Amérique dans ces films n’est jamais fétichisée, au sens traditionnel de la cinéphilie française qui admire Hollywood pour mieux vomir le cinéma populaire national. La France chez Tavernier n’est jamais l’objet d’un rejet. Même quand il tourne l’un de ses rares films anglophones (La Mort en direct), c’est pour aborder les décors typés de l’Écosse avec les manières du cinéma français (SF en creux et suggérée, dystopie anti-spectaculaire, musique peu aimable de Duhamel, cadres calmes et rythme lent). De même, si Tavernier fait de son premier film (L’Horloger de Saint Paul) l’adaptation d’un polar américain, c’est pour l’inscrire profondément à Lyon, sa ville natale, dont les décors et la géographie envahissent le film, devenant objet d’attention en soi, bénéficiant de décadrages dédiés comme si la caméra parfois préférait ce décor à l’action… Il faudrait enfin y ajouter la passion profonde dont témoigne le cinéaste pour l’Histoire de son pays (qu’il a radiographiée au complet, des seigneurs médiévaux du XIVe siècle aux petits flics des années 90).
Tavernier sort ainsi de la dialectique que la Nouvelle vague avait initiée (se construire contre le cinéma de qualité française, donc dans l’amour du cinéma américain), se présentant plutôt comme un enfant métisse et assez inédit des deux, seulement contradictoire en apparence (il suffit par exemple de voir Laissez-passer pour comprendre qu’Hollywood et la Continental trouvent un trait d’union évident, à travers les yeux de Tavernier, par le plaisir du cinéma comme artisanat). Et de la même façon que les cinéastes de la Nouvelle vague en leur temps, parce qu’ils étaient justement les enfants d’influences contradictoires (le glamour Hollywoodien et le néoréalisme, l’érotisme Hitchcockien et la nudité frontale de Monika…), ne pouvaient pas être des photocopieurs, les racines hybrides de la cinéphilie de Tavernier4, dont on sait combien elle est diverse et curieuse, ne pouvaient qu’enfanter une forme tout à fait nouvelle, qui résiste et répond mal aux grilles de lectures sclérosées de certains de ses pourfendeurs5.
C’est en cela que le cinéma Tavernier a pu être un véritable continuateur (et non un radoteur) du cinéma populaire français : en le faisant évoluer vers un ailleurs, reprenant ses formes, ses normes, ses codes, pour leur faire vivre d’autres aventures, les éclairer d’autres tonalités. Ce cinéma de savoir-faire assuré, qui se comportait comme un système fermé et autosuffisant, semble chez Tavernier se reconfigurer, notamment sous la mobilité insensée de sa caméra (mobilité cela dit jamais ostentatoire : il faut par exemple un moment pour se rendre compte que Coup de Torchon, au style évident et aéré, est presque entièrement composé de plan-séquences). Les personnages seront souvent en course (Torreton eut pour seule indication de jeu, sur le tournage de Capitaine Conan, que « la caméra n’arrive jamais à le suivre » ; le héros de Laissez-passer est surnommé “Cours-toujours” par ses collaborateurs…). Cette énergie vitale, fureteuse, on la retrouve jusque dans l’éclatement de scénarios dispersés comme si on y avait posé une bombe (c’est particulièrement frappant dans le très centrifuge Laissez-passer, où le spectateur est renvoyé de part en part, comme jeté d’un bout à l’autre du film, d’une histoire à l’autre, d’un genre à l’autre6, aussi éparpillé que les papiers d’Aurenche constellant ses différents points de chute).
Ce renouvellement tient aussi, et enfin, à tout ce qui dissone, à tout ce qui travaille contre le confort immédiat du spectateur : la singulière utilisation de la musique par exemple (toujours en recherche, souvent proche du jazz, volontiers atonale) ; ou encore la façon dont le calme et l’humilité des films peut soudain, comme laissant entrevoir une violence qu’ils pourraient à tout moment déchaîner, laisser place à des batailles brutales et chaotiques (Capitaine Conan, La Princesse de Montpensier)… Difficile après tout cela de reconnaître encore à l’image ce qu’un certain cinéma populaire français put avoir de surplace, de pessimisme complaisant, ou de goût du confort.
Contre l’histoire, tout contre
Peut-être une meilleure manière de cerner le cinéma de Tavernier est de le regarder comme une série d’évitements, de rejets et de refus. Cela peut sembler contre-intuitif à propos du cinéaste du consensus cinéphile, qui transcendait les découpes établies et les guerres de tranchées critiques. À y regarder de plus près, pourtant, beaucoup de ses films sont motivés par l’arrachement à un certain nombre de conventions. Il n’est pas difficile de voir, par exemple, combien L.627 s’est construit tout entier contre les schémas du polar Melvillien : flics en équipe (et non solitaires), enquêtes abordées par le biais du travail, du social et du manque de moyens (et non par l’angle criminel, aucune affaire ne faisant continuité) ; mélange de tons (et non un sérieux de pape) ; approche documentée (et non romanesque) ; refus des visages et acteurs-types du film policier d’alors (d’où le choix de Didier Bezace, à qui l’on colle cette improbable moustache)…
Cette construction du film “en refus” est chez lui fréquente, mais se joue en fait plus souvent au niveau historique. La Passion Béatrice entend ainsi déromantiser le moyen-âge, le sortir de son imagerie chevaleresque et courtoise, le ramener à sa réalité pragmatique (quitte à verser dans un autre extrême aujourd’hui à son tour déconstruit, celui du moyen-âge comme “dark age”). On retrouvera pareillement, dans La Princesse de Montpensier, des scènes comme la description crue et glaciale d’une nuit de noces, où la défloration se fait dans une chambre remplie… Que la fête commence travaille lui à une désacralisation de la Renaissance, moins par sa représentation d’un siècle d’orgies et de débauches (qui pourraient encore relever de l’imagerie), que par une caméra à l’épaule cassant les habitudes du cinéma en costumes, et surtout par ce souci du détail refusant le beau tableau d’époque : ces nobles qui pissent dans les seaux qu’on leur avance, les serviteurs commentant la première éjaculation nocturne du jeune roi, ces enfants qui jouent aux fléchettes dans les tableaux, ou encore ces tabourets Louis XV qu’on déplace d’un coup de pied négligent, que l’on traite pour ce qu’ils sont alors – des objets du quotidien.
On pourrait y voir une posture (une série d’insolences ostensibles) ; il serait plus juste d’y voir une esquive. La clé pour comprendre la démarche de Que la fête commence, c’est au fond moins ces détails historiques crus qui enguirlandent le film, que le sobre écriteau qui ouvre le récit : « 4 ans après la mort de Louis XIV ». Autrement dit, à la marge de la grande Histoire, au creux d’une période méconnue (la régence) et d’une géographie négligée par le roman national (la Bretagne, la Louisiane), que notre mémoire collective a peu investies. C’est André Loez qui le remarquait dans un épisode de son excellent podcast : le cinéma de Tavernier, pour parler de l’Histoire, choisit presque toujours la périphérie, l’attaque latérale, comme une manière détournée de faire le portrait plus libre, plus inventif, plus suggestif, des grandes périodes qu’il jouxte.
Aucun des films historiques de Tavernier n’y échappe. La guerre de cent ans ne sera qu’un prologue de La Passion Béatrice (qui la résume plus tard à un récit déceptif de couardise au combat). La Saint-Barthelemy, dans La Princesse de Montpensier, n’est l’affaire que d’une rapide scène du final, presqu’un épilogue, surprenant tant le spectateur que les personnages occupés à d’autres buts… La guerre entre catholiques et protestants s’y retrouve plus généralement rejetée aux bords du film (comme sans cesse fuie après sa violente ouverture), toujours remise à plus tard ou à plus loin, le récit transportant l’héroïne dans un château justement choisi pour être au plus loin des batailles. Les deux premiers films que Tavernier consacrera à la première guerre mondiale se situeront eux aussi à l’extrême bordure du conflit : derniers combats aux confins de l’Europe de l’est (Capitaine Conan), ou recherche des disparus deux ans après les faits (La Vie et rien d’autre). Et même quand il s’agit d’attaquer l’Histoire de front, en l’occurrence de faire sortir la guerre d’Algérie du tabou et de l’oubli (La Guerre sans nom), Tavernier annonce d’emblée qu’il ne racontera l’évènement que par un prisme tout à fait inhabituel : 30 ans après les évènements et non par les archives, seulement par les souvenirs d’anonymes et de petits grades (et non de responsables militaires, politiques ou historiens), en utilisant uniquement des photos d’amateurs, et en se limitant à la seule ville de Grenoble… Même quand Tavernier adapte Dumas ou Lafayette, c’est pour un de leurs romans secondaires et moins connus !
On peut y voir le signe d’un besoin de liberté (parler d’Histoire sans avoir de comptes à rendre à l’imagerie nationale), ou encore la preuve d’une passion érudite (l’envie de documenter une époque mal connue, la conception du film se doublant alors de la joie des recherches historiques et de leur effervescence, dont la curiosité contamine ensuite le film). Mais regarder ainsi l’Histoire de biais est aussi le moyen de parler plus directement de ses enjeux, de ses dynamiques, par-delà la lourdeur des grandes dates historiques. On ne peut par exemple que constater l’efficacité de Tavernier, dans Le Juge et l’assassin, à dépeindre les grandes dynamiques de la fin du XIXè siècle (l’ascension de la bourgeoisie, l’essor de l’anarchisme, l’antisémitisme), et à radiographier l’ambiance de tout un pays (jusque dans la mise en avant des chansons populaires), par le biais d’un simple fait divers. De même, et malgré toutes les réserves que le film m’inspire, Coup de torchon parvient à raconter la violence de la colonisation sans presque jamais directement en parler (l’intrigue se déroule majoritairement entre blancs), par le miroir de multiples rituels d’humiliation et de meurtres tranquillement possibles, d’un territoire sans loi aux valeurs envolées – si je peux battre le villageois noir et le tuer sans trop de conséquences, pourquoi me priver de simplement me débarrasser de tous ceux que je n’aime pas ?
Le film qui bénéficie le mieux de cette approche historique “en biais” est probablement Laissez-passer, grande confrontation de Tavernier à la seconde guerre mondiale. On y retrouve tout son positionnement condensé : celui d’un film d’abord construit “contre” (célébrer le cinéma français des années 40, qu’une certaine cinéphilie a voulu effacer), d’un récit marqué par une frénésie à documenter (l’exploration de l’histoire absurde et méconnue de la Continental), et le choix de parler de la France occupée par un détour périphérique (celui de l’industrie du cinéma). Plus que la collaboration (réduite à des personnages périphériques) ou la résistance (abordée sur un mode burlesque au travers du jeu ahuri de Gamblin), c’est tout le reste du pays qui intéresse Tavernier, celui des multiples nuances de gris entre petits gestes d’entraide et de compromission, dans un quotidien de privations avec lequel il faut composer7. Le fait que Tavernier soit fils de résistant, tout comme ses engagements connus à gauche, lui donnent par ailleurs toute latitude pour attaquer les aspects problématiques de la résistance comme de la CGT, sans se paralyser de gênes.
Ces entrechats historiques sont brillants, mais exposent aussi les limites de la méthode Tavernier. Devaivre et Aurenche, les deux héros du film qui ne se croisent que subrepticement et sans se parler, pourraient être ces deux Frances qui ignorent leur existence respective, la résistante et celle qui a dû s’arranger, celle des actions concrètes et celle qui ne s’opposait que par les principes et les mots. Mais cette dialectique compliquée est comme emportée par le tourbillon vivant, mouvant, de l’approche qu’a Tavernier face à l’Histoire (une envie de retrouver, dans chaque époque, le chaos du détail et l’énergie du quotidien) : la guerre finit par ressembler à une grande et joyeuse aventure. Les petits arrangements multiples de ce monde baroque et foutraque font le portrait d’une France finalement relativement docile, où le premier fouteur de merde est la Continental qui limite le mètre de pellicule, et où la question des déportations juives est une affaire de dispute bourrée à table, comme les repas de famille au moment de l’affaire Dreyfus. La réalité du nazisme ne se rappelle que par des éclairs périphériques (comme toujours, périphériques…), en débuts ou fins de scène fuyantes, là un tabassage d’anonyme ou ici un bus amenant des déportés, qui font comme un arrière-fond inquiétant au récit, mais que les personnages croisent si vite qu’ils regardent bientôt ailleurs pour revenir au rythme survolté de leurs péripéties personnelles.
La Danse et le tract
Ce qu’on retient de la filmographie de Tavernier cependant, c’est moins la substance de ces visions historiques que la narration qu’il a inventée pour nous les transmettre, et dont on a déjà un peu parlé. Cette narration si spécifique, caractérisée par l’éclatement, est certes une énième façon de prendre la tangente, d’attaquer l’histoire de biais – par l’anecdote, par l’orgie de détails et de multiples personnages secondaires, comme on lancerait l’offensive de toute parts face à la grande Histoire et ses institutions. Mais ce shoot narratif semble aussi être devenu assez vite une fin en soi : scènes disparates qui s’enchaînent comme sur un coup de tête, furetant chaque minute à un nouvel endroit, rendant le récit imprévisible et toujours rafraichi, courant d’un personnage à l’autre, et d’une situation à l’autre.
Cette narration, il semble qu’elle soit née par hasard, après la sortie du très linéaire Horloger de Saint Paul – et des mains d’un scénariste, Aurenche, qu’on associe plutôt à l’académisme. Lui et Tavernier cherchaient alors à adapter Une fille du régent d’Alexandre Dumas, et se lancèrent dans d’immenses recherches historiques (les premières d’une filmographie qui en comptera beaucoup). Ils découvrent alors une époque, ses détails triviaux, et de multiples situations bizarres ou inattendues qu’ils aimeraient partager. Aurenche aurait donc fini par conseiller à Tavernier d’abandonner l’écriture traditionnelle de leur scénario (trajets des personnages, trames majeures, intrigues et rebondissements…), pour simplement réunir tout ce qu’il avait envie de voir à l’écran. C’est-à-dire de créer des scènes éparses à partir de ses notes de recherche, et de tirer un script de leur simple agglomération. Le résultat fera 500 pages, que les deux hommes travailleront ensuite à élaguer, aboutissant à une suite de micro-scènes dont les personnages émergèrent “tous seuls” si l’on peut dire, naturellement – pour un résultat bien loin du roman adapté, mais parfaitement cohérent.
Il n’est pas très compliqué d’identifier, dans la filmographie de Tavernier, les autres films qui se sont construits sur le même procédé, qu’ils aient un fond historique ou non. L.627 est ainsi un compactage visible d’anecdotes policières (venant notamment du passé de Michel Alexandre) ; Ça commence aujourd’hui est lui un assemblage des histoires réunies par Dominique Sampiero sur la vie scolaire… Le patchwork de témoignages du documentaire La Guerre sans nom, et ses monumentales 4h de métrage, sont l’exemple le plus extrême de cette narration éclatée et ogresque – pas tant dans une démarche wikipédienne que d’une façon débordante, insatiable, chaque thème ou aspect de la guerre devant méthodiquement être passé en revue et déplier l’éventail de tous les points de vue, des communistes objecteurs de conscience aux sympathisants de l’OAS, des tortures françaises à celles du FLN.
Dépassant la simple méthode de travail scénaristique, cette manière narrative éclatée contamine plus largement le cinéma de Tavernier, notamment dans la deuxième partie de sa carrière. On le sent par exemple très bien dans L’Appât (1995), film pourtant très uni (linéaire, peu de lieux, peu de personnages), et qui n’a aucune période historique à nous faire découvrir. On y retrouve pourtant ces scènes qui s’enchaînent à la volée, le montage coupant souvent une situation en cours pour aboutir à la suivante (le passage des cigarettes Kool, celui des clips chez Richard Berry…), jusqu’à cette fin qui tranche exactement quand la désillusion s’amorce, avant même que la situation ne se déplie ou ne se déduise – avant qu’elle ne se mette à ennuyer le cinéaste.
Hors de ce régime haletant, les films de Tavernier sembleront paradoxalement vouloir se trouver une forme strictement inverse : quand son cinéma n’est pas traversé par l’électrochoc de cette énergie interne, l’ensemble s’effondre dans un brouillard dépressif et une narration flottante, qui engluent un peu tout. En résultent des récits hagards et errants (L’Horloger de St Paul, La Vie et rien d’autre, Coup de torchon, La Mort en direct…), comme débarrassés de tout élan vital – à l’image de Noiret exsangue sous le cagnard d’Afrique dès les premiers plans de Coup de torchon, ou du corps larvaire et affalé de Keitel une fois perdu son regard dans La Mort en direct. Cette mélancolie est aussi celle des finals de certains de ses films agités (L.627, Capitaine Conan), quand la tempête narrative disparaît soudain pour laisser les personnages seuls et démunis, pathétiques, abandonnés à un grand sentiment de vide… Cette dialectique se fera particulièrement visible dans Un dimanche à la campagne, avec son monde rural statique et trop tranquille, que le personnage d’Azéma, pure énergie et fuite en avant, vient réveiller tout aussi soudainement qu’elle le renvoie à la mort en repartant.
Ce goût pour la narration éclatée, plus fréquente chez Tavernier à partir des années 90, semble avoir eu quelque chose en commun avec l’élan et la hargne d’une lutte politique, comme il le confiait lui-même dans une interview à DVDclassik8… Et cet éclatement a peut-être été l’antidote, parmi d’autres, à un problème qui traverse et empèse la filmographie de Tavernier : son puissant didactisme.
Tavernier s’amusait, en interview, des accusations de lourdeur explicite qu’on faisait à ses films, dans des textes qui exposaient ensuite un propos qui n’avait rien à voir avec ce qu’il avait voulu dire. On peut en rire avec lui, mais cette anecdote révèle surtout que le problème tient moins aux idées elles-mêmes qu’à une manière de les porter, lourde et signifiante, volontariste. Les exemples les plus connus de cet écueil sont les fins de Que la fête commence et du Juge et l’assassin, qui consistent toutes deux en une soudaine sortie de route (abandonnant le récit, les personnages, se posant soudain sur tout autre chose – ce qui n’est d’ailleurs pas sans leur conférer une certaine singularité9). Le symbolisme lyrique et outré qu’on y déchaîne alors (Que la fête commence), ou le texte démonstratif qui s’affiche à l’image (Le Juge et l’assassin), en font des segments fermement à part, martelant un propos qui semble caricaturer les films qu’ils viennent conclure.
Ces saillies explicites sont d’autant plus notables qu’elles adviennent au sein de films qui n’en ont pas besoin, le politique y tenant plus souvent à une série de configurations bizarres (le mariage de groupe dans Que la fête commence, par exemple) dont l’étrangeté fait spectacle en soi : l’absurdité mise à nue de ces situations est un geste politique bien plus fort et percutant que leur simple dénonciation. Le didactisme moral de Tavernier, homme de gauche et qui entend le faire savoir, se présentera donc souvent non comme une nécessité, mais comme quelque chose qui dépasse, un réflexe qui ressort, posture passagère de maître d’école. Et ce dès son premier long (L’Horloger de Saint Paul), qui bâtit avec une extrême patience la touchante relation entre un homme et son fils, relation politique car subversive, en ce qu’elle fait fi de tout – lois, morale, institutions10. Une dentelle d’ambiguïtés dont Tavernier ne peut pourtant s’empêcher, au dernier moment, de faire la démonstration, via cette scène de l’ami gauchiste sur le pont, dans une tirade maladroite qui s’échine à faire le bilan politique figé et arrêté du récit que l’on vient de vivre.
C’est plus généralement une bonne conscience de gauche qui dépasse chez Tavernier, parfois dangereusement complaisante. C’est frappant notamment dans Ça commence aujourd’hui : si on ne saurait reprocher au film son tableau de misère sociale, dont on a aucun mal à croire la véracité, il en suinte tout de même une condescendance d’homme humaniste et éduqué cherchant à faire le bien des pauvres, tableau qui n’a rien à envier à celui des “bons patrons” d’autrefois. Par exemple ce moment où le directeur, en proposant au père d’une famille misérable de venir montrer son camion de travail aux enfants, a l’air d’un éducateur qui déploie une stratégie pour redonner confiance à l’homme comme on le ferait pour atteindre un gamin de 6 ans. Ou encore cette façon dont le personnage amène un gâteau dans le taudis d’une gamine pour son anniversaire, pour pleurer ensuite avec sa femme dans sa voiture sur combien cette pauvreté est triste, et soudain baiser dans la foulée (excités par la bonté de leur propre geste, peut-être ?), donnant un aperçu malaisant de ce qui travaille l’arrière-crâne du film.
Cette assurance morale, dénuée de doutes, est chez Tavernier ce qui a le moins bien vieilli. Toujours dans Ça commence aujourd’hui, le détail de deux mamans musulmanes à qui on propose pour une fête de venir poser dans de fausses tentes bédouines, comme en exposition, achève l’embarrassant patchwork d’une gauche intellectuelle alors entre deux normes, se rêvant déjà ouverte et cosmopolite, mais visiblement pas encore très woke… Le héros policier de L.627, tout à la proximité avec les populations noires qu’il côtoie, s’amusera au détour d’un plan à en imiter l’accent comme un bon Michel Leeb. Et La Guerre sans nom, film qui se conçoit comme à l’avant-garde morale, qui voulait secouer son époque, paraît aujourd’hui étrange dans sa manière de se limiter strictement au seul côté français, aux seuls états d’âme de ses soldats : quand le film, dans son désir d’exhaustivité, passe 5 mn à parler de la qualité des rations alimentaires, il apparaît déplacé face à ce qui est à présent d’abord vécu, dans tous les esprits, comme un conflit colonial (ici presque discuté comme on le ferait d’une guerre “normale”).
L’ironie est que le principal intérêt politique de ce documentaire existe presque aux dépends de Tavernier lui-même… Si La Guerre sans nom, à sa sortie, valait d’abord pour les mots qu’il posait sur une guerre taboue (c’est dans le titre même du film), il est surtout précieux aujourd’hui pour le portrait qu’il fait de sa propre période, celle du tournage. On voit bien comment chaque intervenant vieilli y essaie de se positionner éthiquement face à la guerre qui a eu lieu, et notamment face à la torture (tout le monde en parlera, sans chercher à la dissimuler), choisissant d’assumer ou de se justifier, de prendre ses distances ou non avec le jeune homme qu’ils étaient tous alors… Se révèle ainsi le portrait d’une génération vieillie à la frontière, encore un pied dans le temps d’avant (où l’on obéit quoiqu’il arrive à l’ordre donné, où l’on n’interroge pas le devoir pour la patrie même si on ne l’aime pas, ou l’on respecte l’ennemi comme “courageux adversaire”…), et un autre pied déjà dans un besoin moderne et naissant de s’individualiser (par une remise en question des soubassements du conflit, de son propre engagement, de la possibilité de protester les ordres, ou de dénoncer les choix faits).
Si l’on veut apprécier la dimension politique des films de Tavernier, il faut donc détourner les yeux des encarts explicites et de leur fierté vertueuse, pour porter plutôt attention, une fois encore, au geste long. Que la fête commence vaut par exemple surtout, sur le plan politique, pour la façon dont la caméra de Tavernier y refuse la hiérarchie que le genre demanderait : les domestiques y font souvent pleinement partie du plan, perpétuelle agitation qui côtoie à égalité ce qui devrait y être principal, rappelant constamment que l’aristocratie (ses intrigues, le moindre de ses dialogues, son romanesque…) n’existe pas sans cette foule qu’elle écrase. Même geste politique discret dans L’Appât, qui en voulant documenter un fait divers meurtrier, documente en fait soigneusement une France contemporaine de la débrouille, plongée dans les affres de la démerde11, baignant au milieu des rêves illusoires de richesse et de célébrité, nourrie en cela par la TV qui ronronne dans chaque plan, ou par une discrète aspiration au savoir (le joli fil rouge de l’encyclopédie). Sans parler de ces cas où Tavernier attaque un milieu social par le biais paradoxal de ses propres personnages (le régent dans Que la fête commence, Brialy dans Le Juge et l’assassin), venant incarner une haute société qui a soudain le dégoût d’elle-même, une conscience ou lucidité de sa putréfaction – et de sa fin nécessaire
Aux héritiers absents
Quel avenir pour le cinéma de feu Tavernier, quelles suites ? Au-delà des querelles critiques et cinéphiles dont il a été l’objet (et qui ont résonné jusque dans ses nécrologies), le cinéaste apparaît aujourd’hui d’abord comme l’homme de la synthèse, qui a su toucher du doigt, au plus près, ce fantasme de “film populaire d’auteur” français, arlésienne qui a encore bien du mal aujourd’hui à trouver des expressions qui y soient parvenues autrement qu’en déposant les armes devant le cinéma américain (la branche Audiard), ou au prix d’une adoration antiquaire pour une France qui n’existe plus (la branche Jeunet). Sur ce plan, le cinéma de Tavernier s’apparente à la résolution d’un problème national, trouvant une autre position vis-à-vis du cinéma populaire français passé qu’une simple envie de le dynamiter, ou à l’inverse de le lustrer. Il aurait en cela pu servir de base ou de modèle pour tout un “cinéma du milieu” que la profession appelle sans cesse de ses vœux. Or qui, aujourd’hui, se revendique du Tavernier cinéaste, ou en perpétue la manière ? Qui a hérité de lui autre chose que son legs cinéphile ?
En regardant la façon dont, ces derniers mois, la cinéphilie pointue a tenté de se réapproprier Tavernier, je suis souvent retombé sur un titre : La Passion Béatrice. Le casse-tête de l’héritage, de ce côté de la critique, ne semble ainsi avoir été soluble que par le joker d’un film qui joue Tavernier contre lui-même… La Passion Béatrice se présente en effet comme une incise brutale dans sa filmographie, tant au niveau du style que de la narration : c’est un film sec, fait de ruptures brusques et d’ellipses, dépouillé dès les premières scènes de son décorum (dans une séquence maligne qui dépouille le château dans le récit en même temps qu’elle épure les décors du tournage), et coloré d’un jeu d’acteurs Bressonien. Même le goût des recherches documentaires et de leurs mille détails, biais par lequel Tavernier attaque si souvent le film d’époque, cède ici le pas à un certain minimalisme : le passé est davantage abordé via une idée préconçue (celui d’un âge des pulsions) que par le poids des recherches historiennes (et ce aussi vraisemblable que soit ce moyen-âge à l’image, adoubé par Jacques Le Goff lui-même). Le film semble alors s’aligner avec une série de productions qui, la décennie précédente, avaient abordé le film d’époque sous l’angle austère de la modernité (de Moi, Pierre Rivière à Lancelot du lac).
Mais rien à faire : Tavernier dépasse de partout – et ce dès le carton d’ouverture au didactisme redoutable. L’aisance narrative du cinéaste reprend vite le dessus, l’habituelle compilation de recherches historiques (ici délaissées) se réincarnant en une compilation d’horreurs cherchant à choquer le spectateur. Vision torve du monde (dès ce bébé dans la neige), récit qui communie en grandes scènes symboliques (Nils Tavernier féminisé et pris en chasse) : la qualité française n’est soudain plus très loin. Il semble surtout qu’à force de compiler, le film ne sait plus très bien ce qu’il raconte : l’empire progressif du diable sur ces terres (ce serait le côté cinéma de genre, auquel le prologue fait beaucoup penser – le film hérite d’ailleurs explicitement de Freda) ? Le récit métaphorique de la fin d’une enfance, et d’une projection brutale dans l’âge adulte ? L’avènement d’un féminisme ou d’un proto-athéisme ? Un pamphlet contre la lâcheté de tous ceux qui laissent faire ? Le film amorce beaucoup de pistes passionnantes, mais donne en cela l’impression d’être tiraillé de contradictions internes : la rigueur de la modernité contre le plaisir du cinéma du genre, la recherche documentaire contre la subjectivité d’un âge sombre. En découle un film en forme d’objet dysfonctionnel et démembré, dans lequel chacun peut venir se servir selon ses goûts.
(les deux premiers plans d’Un dimanche à la campagne, 1984)
À chercher d’autres ouvertures, on pourrait également s’arrêter sur Un dimanche à la campagne, qui se démarque par l’inhabituelle importance donnée à la photographie, à une sensorialité visuelle et sonore qui là encore tiraille le naturalisme soucieux de reconstitution (et ce bien au-delà des références picturales explicitement convoquées, qui sont ici seulement affaire d’imagerie) : captage des lumières du soleil entre les arbres, de derrière les volets, collier d’atmosphères ; mais aussi entrecroisement de bruitages, d’ambiances, de dialogues, entendus de près ou de loin, comme autant de signaux épars dessinant constamment l’étendue de l’espace alentours…
Ces originalités restent des exceptions : personne ne retient Tavernier en cinéaste moderne qui s’ignore, pas plus qu’en cinéaste sensoriel. Le véritable héritage est donc peut-être à chercher sur des versants plus concrets et pragmatiques de sa filmographie, à commencer par celui des nombreux comédiens qu’il a révélés. À ce titre, regarder les films de Tavernier aujourd’hui n’est guère dépaysant, en ce qu’ils sont peuplés de jeunes acteurs à présent célèbres, et dont il lançait (ou accélérait) alors la jeune carrière : Christine Pacal, Julie Delpy, Eddy Mitchell acteur, Gérard Lanvin, Frédéric Pierrot, Marie Gillian, Bruno Putzulu, Philippe Torreton, Raphaël Personnaz… Ces découvertes ne sont pas dues au hasard : spectateur de théâtre, Tavernier allait y dénicher des talents, à qui il essayait d’offrir le moindre petit rôle disponible (quelle surprise, par exemple, de découvrir la jeune troupe du Splendid dispatchée au complet parmi les figurants de Que la fête commence). Écouter un commentaire audio de Bertrand Tavernier, c’est d’abord écouter le listing des noms de chaque silhouette ayant le malheur d’apparaître à l’écran, acteur ou actrice dont il connaît parfaitement le parcours et qu’il s’enthousiasme d’avoir réussi à faire tourner, ne serait-ce que pour une phrase… Il offrira également à des comédiens reconnus le rôle-clé de leur carrière : Jean Rochefort voit ainsi dans L’Horloger de St Paul un tournant dans sa manière de jouer et dans la nature de ses rôles ; Un dimanche à la campagne permit à Michel Aumont de sortir de ses personnages de commissaires ; et Didiez Bezace, Sabine Azéma, Jacques Gamblin, Michel Galabru, ou bien sûr Phillipe Noiret, offriront chez lui leurs meilleures performances, d’ailleurs honorées de multiples récompenses.
trois comédiens dont la carrière est propulsée par L’Appât (1996)
Cette passion du casting, chez Tavernier, est peut-être plus fondamentalement une passion pour les visages et les personnalités qui en émanent, puisqu’on la retrouve intacte dans La Guerre sans nom (documentaire presque uniquement composé de gros plans), où se succèdent les figures émues et leurs identités douloureuses – au point d’en remplir quatre heures d’anecdotes pas toujours essentielles… C’est aussi par cette passion des comédiens que parfois son cinéma se fragilise : l’ennui latent d’Un dimanche à la campagne tient entre autres à une trop grande confiance aux acteurs, le goût du portrait se substituant à la dramaturgie ; et l’envie de mettre en valeur de jeunes talents se fait parfois au détriment des films eux-mêmes, comme dans L’Appât, qui caste l’excellent et très beau Bruno Putzulu dans le rôle d’un jeune homme qu’on arrête pas de qualifier de moche pour les besoins de l’intrigue (aboutissant à quelques passages assez kafkaïens) ; on peut aussi citer le cas très commenté de Grégoire Leprince-Ringuet dans La Princesse de Montpensier, casté pour le côté fuyant, timide, et humilié que son style de jeu apporte naturellement au personnage, mais dont la caméra de Tavernier ne semble pas vouloir remarquer le phrasé gêné et éteint, clairement problématique, et peu adapté aux dialogues d’époque.
Cet amour profond pour les comédiens, qui célèbre le jeu d’acteur sans le réduire au fétichisme parolier ou au goût des tronches du cinéma populaire d’antan, ni aux performances à happening du cinéma naturaliste, ni encore à l’objet neutralisé du cinéma moderne (le tout en déployant une mise en scène qui sait s’adapter à eux sans se vautrer dans une bouillie de captation anonyme), reste il me semble l’héritage le plus intéressant que nous ait laissé Tavernier – le seul en tout cas qui ait quelque chance d’avoir nourri le cinéma contemporain. Pour le moment, tout du moins : il n’est pas interdit de penser que la mort du cinéaste (et le révisionnisme critique qu’elle va immanquablement engendrer, mettant peut-être fin aux conflits de chapelle débiles), tout comme la mise à disposition tardive de sa filmographie (sur Netflix, dans les éditions blu-ray en préparation…), fasse découvrir aux jeunes aspirants cinéastes un modèle clé-en-main pour concilier le cinéma français qu’ils habitent, et leur inévitable amour de l’Amérique.
Films vus, films à voir
Voici la liste des longs-métrages de Tavernier ayant fait l’objet d’une sortie en salles (notons que cela exclut au moins deux productions TV considérées comme des étapes notables de sa carrière, et que je n’ai pas vues : son documentaire De l’autre côté du périph, co-réalisé avec son fils Nils Tavernier en 1997, et sa série cinéphile Voyages à travers le cinéma français, en 2017, prolongeant directement le travail du film du même nom).
Dans la liste qui suit, les films que je n’ai pas vus sont en gris, et mes films préférés sont soulignés. Mais il me faut préciser que jusqu’au plus raté (La Mort en direct), ou même pour celui ayant provoqué chez moi un rejet complet (Coup de torchon), tous ces films vus me semblent assez singuliers, intéressants et investis pour mériter une vision (je pense notamment à La Vie et rien d’autre et à Un dimanche à la campagne – deux films pour lesquels j’ai moins d’amour, mais qui me semblent assez irréprochables). Enfin, revoir L.627, deux décennies plus tard, me l’a fait réévaluer très à la hausse.
L’Horloger de Saint-Paul (1974)
Que la fête commence… (1975)
Le Juge et l’Assassin (1976)
Des enfants gâtés (1977)
La Mort en direct (1980)
Une semaine de vacances (1980)
Coup de torchon (1981)
Un dimanche à la campagne (1984)
Autour de minuit (1986)
La Passion Béatrice (1987)
La Vie et rien d’autre (1989)
Daddy nostalgie (1990)
La Guerre sans nom (doc, 1992)
L.627 (1992)
La Fille de d’Artagnan (1994)
L’Appât (1995)
Capitaine Conan (1996)
Ça commence aujourd’hui (1999)
Laissez-passer (2002)
Holy Lola (2004)
Dans la brume électrique (2009)
La Princesse de Montpensier (2010)
Quai d’Orsay (2013)
Voyage à travers le cinéma français (doc, 2016)
Notes
2 • Parmi les aveuglements des films à ce sujet, on pourrait citer Que la fête commence, et cette scène du régent qui explique qu’il ne touchera à son innocente petite pupille (pour qui il prépare un palais de luxure) que si elle en a envie ; un passage qui semble s’émouvoir de la noblesse d’esprit du personnage, sans avoir l’air de s’interroger sur le sordide d’une jeune adolescente qu’on fait venir de son couvent, sans qu’elle le sache, dans un domicile entièrement dédié à la déflorer…
3 • Notons bien qu’il n’est ici question que de mise en scène, et pas du comportement de Tavernier lui-même. Les propos de Julie Delpy restent ambigus sur la nature exacte de l’oppression que Bernard-Pierre Donnadieu, « un acteur complètement fou (…) qui s’identifiait à son personnage et terrorisait tout le monde », lui a fait subir sur le plateau : elle parle d’un « tournage très difficile, presque un cauchemar » où elle était sans cesse « emmerdée par [son] partenaire » (ce qu’elle confie au sein d’un entretien portant plus largement sur le harcèlement sexuel qu’elle a souvent subi en tant que jeune actrice). Elle n’en tient cependant pas Tavernier comptable, au contraire : « Bertrand a été très protecteur avec moi, d’une grande gentillesse (…). J’avais des scènes de nu, de viol, c’était très éprouvant. Il fallait être solide pour être une jeune actrice dans les années 1980 ». (propos tirés de deux entretiens avec Julie Delpy, dans Télérama n°3728 et dans Positif n*724).
4 • Contrairement à ce qu’on lit parfois, Tavernier ne s’est aucunement construit contre les films de la Nouvelle vague, qu’il appréciait et défendait ; il fut d’ailleurs l’attaché de presse de beaucoup d’entre eux.
5 • Parmi les exemples de “nouvelles formes” issues de cette hybridation, on pourrait citer la mise en scène des batailles – où un rythme éclatant, vivace et fluide, qu’on pourrait sans mal rattacher au cinéma américain, s’exprime sous les formes d’un cinéma français au naturalisme tranquille, sobre et aux plans longs. Que ce soit dans Capitaine Conan, La Passion Béatrice, ou encore dans le bombardement de Laissez-passer, la manière dont ces éléments spectaculaire (multiples figurants, explosions…) sont maniés par une forme qui ne les fétichise pas (vues larges, images aérées, morts qui tombent sans bruit, pas d’édification devant l’horreur) aboutit à un résultat à la fois inédit et tout à fait convaincant.
6 • Il est amusant de remarquer la parenté de ce film avec un autre de la même époque, qui lui aussi ping-pongait son spectateur entre deux personnages, deux tonalités, et deux genres : Rois et Reine de Desplechin, qui fut lui très célébré (et à raison) par la critique.
7 • La séquence habile chez les anglais est sur ce point révélatrice : on dirait voir la France qui essaie en vain d’expliquer aux autres pays qui ne peuvent pas l’entendre, ni même le concevoir, que ce n’était pas noir et blanc l’occupation, que ce n’était pas une romantique histoire de gentils et de méchants.
8 • DVD Classik : On a le sentiment qu’il y a eu une cassure dans votre carrière après La Guerre sans nom : d’abord des films posés, avec des non-dits, des héros réfléchis, au rythme assez calme… puis, à partir de 1992, des films beaucoup plus directs, mettant en scène des personnages constamment en mouvement, comme si votre tempérament reprenait le dessus et décidait de foncer dans le tas.
Bertrand Tavernier : Il y avait déjà une ébauche de cela avant La Guerre sans nom : le personnage de Sabine Azéma, feu follet d’Un dimanche à la Campagne ou encore Julie Delpy dans La Passion Béatrice. Mais effectivement, après La Guerre sans nom, j’ai ressenti une nouvelle énergie, comme une envie de renaître, de repartir à zéro, de refaire un premier film. Les films sont de toutes façons dictés par le monde qui nous entoure, par des déceptions politiques, des désillusions… Écouter les “acteurs” de La Guerre sans nom m’a donné envie de replonger les mains dans le cambouis. Tout à coup, je me suis mis en état d’urgence et suis parti dans une nouvelle voie pour ne pas me répéter. De même, mes enfants m’ont ramené à une réalité à laquelle j’ai alors décidé de me frotter : les problèmes de drogue de mon fils, qui ont inspiré L.627, en sont le meilleur exemple. Autant d’événements qui ont déclenché une folle envie de vaincre mes peurs, mes pudeurs et de retourner au charbon. (La Passion Créatrice, entretien de Bertrand Tavernier avec DVDclassik, septembre 2005)
9 • Il y en effet là une idée assez stimulante sur le papier : opérer un décadrage brutal et radical, non annoncé, vers tout ce monde ignoré qui continue à vivre ailleurs et tout autour, vers des problèmes qui existent bien au-delà de la mélancolie du régent et de ses tourments moraux que les deux heures de film nous ont fait partager – tourments qui soudain apparaissent déplacés, dérisoires, indécents, petit problème de riches à côté de la misère du monde. Cette manière de prendre le spectateur en défaut, de lui refuser un final lié aux personnages et de l’arracher aux protagonistes auquel il s’était attaché, n’était pas sans potentiel. Et aurait pu fleurir si la scène avait su en manier les implications, sans cette extrême lourdeur de ton.
10 • De même d’ailleurs pour la manière habile dont est utilisé Jean Rochefort, personnage institutionnel à qui “on a rien à reprocher”, qui est aimable et sympathique, mais qui au fond ne peut être abstrait de ce qu’il représente, de la domination sociale qu’il sert – et dont la sympathie, la complicité, la familiarité, deviennent au fur et à mesure insupportables.
11 • D’ailleurs, si L’Appât n’est franchement pas le film le plus réussi de Tavernier, on peut lui reconnaître cette originalité : celle d’être un film tout de suite dans l’échec, dans les coups qui s’annoncent foireux et qui le sont d’emblée, qui patinent immédiatement. Le récit évite la séduction douteuse d’une promesse grisante de succès qu’il nous ferait partager, et qu’il viendrait ensuite pervertir.












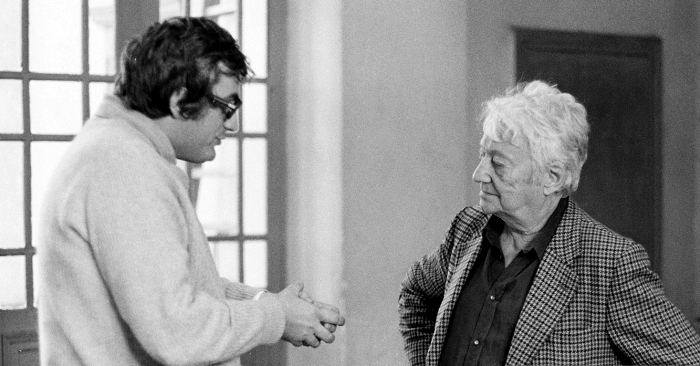







Tres bon article sur un grand monsieur du cinéma français pour moi.
J’aime aussi beaucoup Holly Lola et pour moi la fille de d’artagnan est le princess bride francais.
Tu peux aussi tenter les enfants gâtés ( tu reverras quasi toute la troupe du splendid) qui est un film étrange et quasi biographique ( Tavernier n’est il pas Le Piccoli du film ?)
Merci Degryse l (quelle promptitude ! Je comptais encore faire une dernière relecture, j’espère qu’il reste pas trop de fautes…)
Merci pour les conseils :-)
La Fille de d’Artagnan sur le papier, et au vu de la filmo du bonhomme, me motive assez il est vrai, mais j’en ai une image nanardesque qui fait que je pensais mon intuition peu fiable, et je lui ai pas redonné sa chance… Pareil pour Holy Lola, sa réputation mineure et de “film à message” était telle que je l’ai pas gardé dans les rattrapages – cela dit, je trouve Gamblin tellement excellent dans Laissez-passer (mais vraiment, j’ai été soufflé, rien que tout le travail de sa voix enrhumée dans le dernier quart…) que ce serait une raison à soi seule de voir le film.
Je note pour Les Enfants gâtés, celui-là je sais carrément pas de quoi ça parle ! Dans les rattrapages possibles j’étais aussi curieux d’Autour de minuit et Dans la brume électrique, pour voir ce que ça donne quand ça se frotte aux USA, vu les rapports profonds que sa filmo a avec le pays…
Tout cela sera pour plus tard, cela dit, il faudrait que je rattrape un brin de cinéma international avant la fin de l’année.
Super article !
Merci
Et ben de rien :-)
ToM rEvIeNs
(pas)
(sans rire, c’est pas plutôt Denis que Bruno Podalydès sur la photo ? de rien, bisous)
Heeey Freak !
Mais si purée (la honte…). Je change, merci !
Article particulièrement éclairant, bravo pour ce travail.
J’ai particulièrement apprécié lire le passage sur “l’histoire de biais”, je crois que je n’avais pas réalisé cela à l’échelle de sa filmo. Je n’ai pas encore vu Que la fête commence et ne connaissais pas l’existence de ce film période 39-45, Laissez passer. On dirait que cette façon de faire, de privilégier le petit récit ou l’histoire la moins racontée, lui permet de jouer sur les deux tableaux : la reconstitution 1er degré, celle des grands courants et des grandes époques, à l’intérieur desquels il place ses émotions, ses personnages, ses propres histoires et ses propres originalités. Conan est très fort pour cela. Idem avec Coup de torchon. La vie et rien d’autres est au-dessus de tous.
Je regrette d’ailleurs un peu que tu ais moins aimé La Vie et rien d’autre et dans une moindre mesure Un dimanche à la campagne.
Sinon, j’ai vu la série Voyage à travers le cinéma français : extraits remarquables, amour des comédiens sur lequel tu écris toi-même quelques lignes, comparaisons audacieuses… La série (et le film certainement) permet de faire de nouveaux choix dans cette liste énorme de films. Superbe travail de cinéphile.
Merci Benjamin !
Pour le coup de l’histoire en biais, faut vraiment rendre tribut au podcast “Paroles d’histoire”, c’est eux qui ont réussi à me donner la clé de tous ces rapports bizarres à l’histoire dont je n’arrivais pas à saisir la cohérence. Mais oui, c’est tout à fait ce que tu décris, il gagne sur les deux tableaux.
Sur le duo “La vie et rien d’autre” / “Un dimanche à la campagne”, c’est probablement parce que ce qui m’a impressionné le plus chez Tavernier est le modèle narratif en patchwork / en fuite (qui fait que j’ai absolument adoré “Laissez-passer” alors qu’il semble bien que je sois le seul !), et que ces deux films n’y répondent pas. Mais ils restent impeccables tous les deux.
“Voyages” me tente énormément bien sûr, mais comme pour le docs de Scorsese, j’ai peur de me faire spoiler les meilleures scènes de tous ces films…